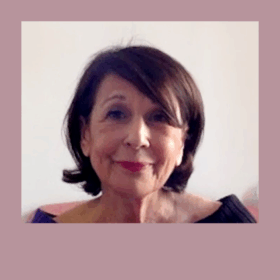Le 3 février 2025 à Paris s’est tenue la Soirée de l’AMP inaugurant le travail vers le XVe congrès, qui se tiendra au printemps 2026 à Paris sur le thème « Il n’y a pas de rapport sexuel ». Introduction par Christiane Alberti, présidente de l’AMP.
Le titre de ce congrès « Il n’y a pas de rapport sexuel » appelle d’emblée une remarque : c’est la première fois que le terme de « sexuel » figure dans le titre d’un congrès de l’AMP. L’occasion nous est donc donnée d’interroger ce qui a fait le scandale de la découverte freudienne, mais aussi son succès si l’on considère que Freud a contribué à la dissolution de la morale sexuelle civilisée, en portant au grand jour l’importance du sexuel dans l’économie psychique, jusqu’à pointer la sexualité infantile. Il en a étendu la signification, bien au-delà de l’accouplement animal et de la génitalité, en considérant par exemple que, dans la sexualité infantile (se référant au pédiatre Lindner [1]), c’est dans le suçotement qu’il faut voir le prototype de la pulsion sexuelle : une revendication primaire, primordiale de volupté, indépendante du besoin vital, un état du corps silencieux en relation avec lui-même. Comme il l’écrit, de manière radicale, dans « La morale sexuelle “civilisée”… » : « la pulsion sexuelle n’en fait qu’à sa tête » [2].
Depuis l’époque de Freud, un changement radical est intervenu dans la sexualité. La sexualité est omniprésente, rendue visible, s’étalant partout sur la toile et les réseaux sociaux. Lacan avait souligné, peu avant 1968, dans Mon enseignement, cette évidence que le véritable changement est là : la sexualité a perdu quelque chose de la jouissance clandestine et transgressive pour laisser place à une sexualité qui a « quelque chose de beaucoup plus public […], en plein vent » [3]. De ce fait, les sujets se voient délestés d’une parcelle d’intimité et de secret et comme précipités, hors d’eux-mêmes, sur la scène publique. C’est d’autant plus présent actuellement à l’époque du développement de la sexualité dans les espaces numériques.
Une enquête récente et très documentée de l’INSERM sur l’évolution de la sexualité des Français de 15 à 89 ans a récemment publié des résultats qui méritent d’être relevés [4].
Les résultats confirment d’abord des tendances qui ne sont pas nouvelles : changements majeurs liés à la promotion de la norme d’égalité́ entre les sexes et les sexualités, et bouleversements profonds des structures familiales dans un contexte où la loi étend l’accès au mariage et à la parentalité.
Le plus intéressant est ce qui est épinglé comme nouveau et qualifié de « paradoxe contemporain de la sexualité́ » [5]. Il se caractérise par une plus grande diversité́ de l’activité sexuelle – augmentation du nombre de partenaires, extension des « répertoires » sexuels (moins de pénétration et plus de masturbation) –, en même temps qu’une moindre fréquence des rapports sexuels. Ces tendances sont également observées dans d’autres pays (Allemagne, États-Unis, Finlande, Japon, Royaume-Uni).
D’une certaine manière, ces éléments ne sont pas étrangers à ce qui se retrouve dans l’adresse à la psychanalyse. C’est notamment le cas des sujets qui, dans la multiplication effrénée de partenaires, sous l’impératif d’une jouissance permanente et immédiate, s’abandonnent non pas au destin que leur fait l’inconscient, mais à une consommation où s’annule toute division dans la stricte dépendance corporelle ; la sexualité rejoignant ainsi le régime des addictions comme autant de formes de comblement du vide. C’est dans l’acting que le sujet se défend de la honte.
Mais ce sont aussi les cas où la sexualité est mise à distance sous la forme du couple fraternel, le duo en miroir, dans lequel l’illusion de faire un est portée à son comble, dans l’évitement ou la dénégation des embrouilles de l’amour et du désir.
En un sens, Lacan nous donne une lecture de ce dit paradoxe à travers ce qu’il appelle dans le Séminaire XI, « désexualisation » [6]. Dans un contexte civilisationnel où l’avoir a pris le pas sur l’être, où l’objet est aux commandes, les observateurs contemporains considèrent que l’ordre érotique s’aligne sur les impératifs du marché, de manière, disons désincarnée, désaffectée. Lacan nous en donne une autre lecture, moins simpliste, éclairant plus précisément ce qui se produit quand les objets de la réalité prennent le pas sur la cause intime du sujet. Il indique à propos de l’objet oral que la zone érotisée ne vaut pour la satisfaction pulsionnelle que pour autant que d’autres zones, désexualisées, en sont exclues. Mais que se passe-t-il dans le mouvement inverse, quand c’est l’objet sexuel lui-même, le partenaire, qui file vers la pente de la réalité ? Le sujet, nous dit Lacan, entre alors dans une zone de chute appelée fonction de la réalité. La réalité prend le pas sur le réel pulsionnel, la viande sur le corps. Ne peut-on y voir une clé de lecture du désenchantement, ou cynisme, contemporain en matière sexuelle ?
Le reste de l’enquête met en exergue à quel point la question de l’attentat sexuel y occupe une place prépondérante : un pas est franchi dans l’ordre d’une culture du contrat, notamment pour s’assurer du consentement [7]. Il faut relire ici « Kant avec Sade » [8] pour mesurer qu’une société du contrat, loin d’y faire obstacle, encourage le cynisme de la jouissance et de nouvelles « lois de l’hospitalité » comme le mélangisme.
Aujourd’hui, l’imaginaire de la rivalité entre hommes et femmes tend à se réduire au mode de l’affrontement, de la radicalité sans nuances. À travers les revendications, c’est le régime de l’égalité absolue des sujets qui prend le pas sur la différenciation des jouissances homme et femme, la différenciation des jouissances tout court, à travers l’illusion d’un partage identitaire de la jouissance. L’axiome sous-jacent est celui de la séparation des sexes, laissant chacun à sa solitude pulsionnelle. Il s’agit de se déprendre de l’Autre, toujours suspect de violence [9], du viol de l’être. La dissymétrie avec le grand Autre y est dénoncée comme rapport de domination, là où Lacan affirme que seul l’artefact de l’Autre rend possible ce qui est de l’ordre du sexe, du rapport sexué [10].
Ne nous y trompons pas, il y a dans ce séparatisme non pas une mise à nu du non-rapport mais une désexualisation qui prescrit le rapport sexuel qu’il faudrait, qui le fait exister dans une dénégation.
Cela suppose de revenir au « il n’y a pas » de l’aphorisme « il n’y a pas de rapport sexuel ». Jacques-Alain Miller le commente ainsi dans la Conversation d’Arcachon : « Le “Il n’y a pas” de Lacan, c’est la page blanche, ce n’est pas inscrit. On doit distinguer la négation d’une proposition écrite, de la non-écriture de cette proposition. » [11] J.-A. Miller en a proposé une écriture en représentant l’absence de rapport sexuel avec simplement le symbole de l’ensemble vide, et écrit au-dessus « le sigma du symptôme ». Dans ce « il n’y a pas », il s’agit d’un autre manque que celui de la forclusion. Le « il n’y a pas de rapport sexuel » n’est pas un trou : c’est un pur « il n’y a pas ». C’est donc en tant qu’« inscriptible, fondable, comme rapport » [12] que le rapport sexuel n’existe pas. Nous aurons donc ici à interroger la vraie valeur de ce qui s’écrit.
Lacan l’affirme clairement dans « L’étourdit » : « L’il n’y a pas de rapport sexuel n’implique pas qu’il n’y ait pas de rapport au sexe. » [13] Qu’il n’y ait pas de rapport sexuel qui soit inscriptible est précisément ce qui conditionne qu’il y ait des relations, – qu’il y ait quelque chose de l’ordre du sexe –, celles que révèlent les liaisons inconscientes ; ces relations qui en passent par la jouissance, le corps et la langue, par le savoir-faire de l’inconscient avec lalangue autrement dit par le symptôme. Liaisons toujours symptomatiques donc. La sexualité a beau être en plein vent, le sexe fait toujours symptôme. On n’en sera pas quitte. C’est là que la psychanalyse joue sa partie, précisément en un temps où le symptôme n’a pas droit de cité dans les discours et est désinvesti par le sujet lui-même.
Ainsi, sur la voie d’un Lacan connecté à l’envers de la vie contemporaine, ce congrès aura à interroger les conséquences de ce « il n’y a pas » sur les mythes modernes de la vie sexuelle et amoureuse. Au temps des Uns-tout-seuls, le désir de faire couple est-il toujours d’actualité ? Quand plus personne ne croit plus au programme du « à chacun sa chacune », l’amour reste-t-il une suppléance privilégiée au non-rapport ? Quelles sont les autres formes de suppléance que révèlent la clinique et la pratique ?
Opacité du sexuel
« La sexomanie envahissante n’est qu’un phénomène publicitaire » [14], disait Lacan dans son interview au magazine Panorama. C’est clair, elle ne viendra pas à bout du mystère de la sexualité. En effet, elle a beau se numériser, comme l’a formulé Éric Laurent, « [le]programme de jouissance n’est pas virtuel » [15].
Dans le séminaire Le Sinthome, c’est justement le terme d’« opacité sexuelle » [16] qui retient l’attention. Toute pensée, toute la connaissance, nous dit Lacan, doit être reconsidérée à partir de l’acte sexuel, le langage lui-même est en rapport avec le sexe. Dans une conversation inédite d’UFORCA sur Le Sinthome [17], J.-A. Miller a éclairé l’opacité dont il est question. Elle ne désigne pas ici l’impossibilité du dire sur le désir sexuel. Elle se présente plutôt comme une tache dans le champ visuel, le sexuel opacifie le champ visuel, face visible du « il n’y a pas ». La référence, précise-t-il, est ici non pas à l’énigme (registre signifiant), mais à l’imaginaire du corps comme consistance du parlêtre. Si bien que la question à résoudre serait : « Comment est-il pensable que l’autre parlêtre adore son corps, et non pas le mien ? » [18].
Cette perspective me semble passionnante, non pas pour faire toute la lumière sur l’opacité, mais pour accepter que la lumière nous regarde, manière de ne pas regarder de trop près, afin que le mystère du sexuel demeure.
[1] Cf. Freud S., « La vie sexuelle humaine », Conférences d’introduction à la psychanalyse, Paris, Gallimard, 1999, p. 397.
[2] Freud S., « La morale sexuelle “civilisée” et la maladie nerveuse des temps modernes (1908) », La Vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 41.
[3] Lacan J., Mon enseignement, Paris, Seuil, 2005, p. 28.
[4] INSERM, Contextes des sexualités en France, 2024, disponible sur internet.
[5] Ibid., p. 39.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les Quatre Concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1973, p. 152.
[7] Cf. INSERM, Contextes des sexualités en France, op. cit., p. 40.
[8] Cf. Lacan J., « Kant avec Sade », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 765-790.
[9] Comme l’indique l’augmentation statistique de la mise en question déclarée du choix hétérosexuel : pour mieux se prémunir des agressions. Cf. INSERM, Contextes des sexualités en France, op. cit., p. 40.
[10] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2007, p. 131.
[11] Cf. Miller J.-A., La Conversation d’Arcachon. Cas rares. Les inclassables de la clinique, Paris, Agalma, 1997, p. 260.
[12] Lacan J., Le Séminaire, livre XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant, op. cit.
[13] Lacan J., « L’étourdit », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 464.
[14] Lacan J., « Entretien au magazine Panorama », La Cause du désir, n° 88, octobre 2014, p. 173.
[15] Laurent é., « Le programme de jouissance n’est pas virtuel », La Cause freudienne, n° 73, décembre 2009, p. 42-49.
[16] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le Sinthome, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 2005, p. 64.
[17] Propos prononcés par Jacques-Alain Miller lors des Journées UFORCA des 21 & 22 mai 2011 qui avaient pour titre « Le parlement de Montpellier, Autour du Séminaire XXIII », inédit.
[18] Ibid.